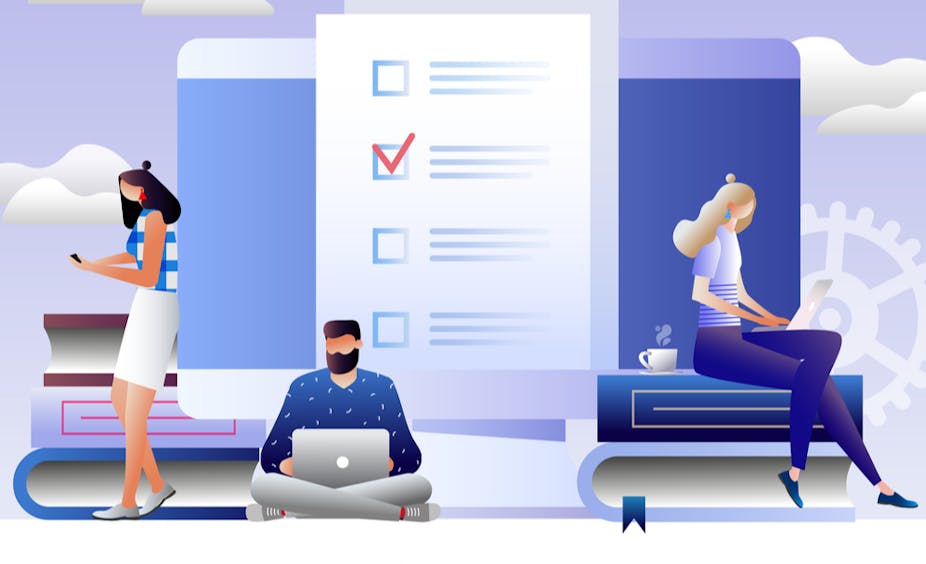Si des pédiatres ont exprimé leur inquiétude par rapport à « l'organisation de la rentrée telle qu'elle se profile » et si des enseignants demandaient un report de la rentrée de quelques jours, le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a confirmé jeudi 20 août que les élèves reprendraient comme prévu le chemin de l'école le 1er septembre. Les aménagements nécessaires se feront au niveau local, en fonction des évolutions de la situation sanitaire.
Quoiqu’il en soit, que les élèves étudient dans leur établissement ou soient contraints de suivre une partie des enseignements à distance, il est une dimension qui ne varie pas : leur parcours d’études reste marqué par les bulletins de notes. On l’a vu avec la dernière session du baccalauréat, bouleversée par le confinement. Si les épreuves terminales ont été supprimées, l’évaluation a pris la forme du continu.
Read more: Réussite aux examens post-Covid : des résultats trop beaux pour être vrais ?
Comment les notes se sont-elles imposées dans le système scolaire ? D’où viennent-elles ? On ne parlera pas ici de l’évaluation au sens large, qui a toujours existé aussi bien dans la famille que dans l’école sous des formes diverses, mais bien de la notation chiffrée – qui permet éventuellement de songer à « mesurer », à « calculer », à faire des « moyennes », voire des « moyennes de moyennes ».
Corrections à l’encre rouge
On peut dire que ce sont les Jésuites qui ont introduit pour la première fois en France les bases de cette notation, au sein d’un système d’émulation très élaboré. Cela remonte aux XVIe et XVIIe siècles. L’organisation de l’appréciation des élèves dans le cadre de ce que l’on appellerait actuellement un « contrôle continu » a été codifiée dans le célèbre « Ratio studorium ». Le niveau, signalé par un chiffre de 1 à 6, permet d’ajuster et réajuster la composition des classes.
Certaines instructions données parallèlement à ce système sont tout à fait significatives :
« La méthode est, avec un crayon rouge, de barrer tous les mots où il y a l’erreur et de mettre vis-à-vis les chiffres 1,2,3 ; et puis ramassez le général. Par quoi, vous pourriez rendre compte à qui le désirerait, soit l’écolier soit le précepteur, de l’équité de votre censure. » (Marie-Madeleine Compère et Dolorès Praton-Julia, « Performances scolaires de collégiens sous l’Ancien Régime », INRP/Publication de la Sorbonne, 1992)
Ce type de consignes aura une pérennité surprenante. Par exemple, les Instructions du ministre de l’Instruction publique relative à la tenue d’un Cahier de devoirs mensuels dans les écoles primaires du 25 août 1884 précisent qu’« il importe que les devoirs soient corrigés à la marge par les instituteurs et qu’ils portent une note, qui pourrait être, pour la facilité des comparaisons, exprimée par un chiffre de 1 à 10 ». Et on sait que ces corrections seront faites à l’encre rouge.
On notera cependant que ces mêmes Instructions mettent en garde contre les dérives possibles de l’émulation :
« Habituer les élèves et les parents à mesurer les progrès de chaque enfant par comparaison non avec les autres, mais avec lui-même, de manière à proportionner le mérite non pas au succès mais à l’effort. »
Quatre ans plus tôt, l’arrêté du 16 juin 1880 avait stipulé que les épreuves d’orthographe, d’écriture, d’arithmétique et de rédaction du certificat d’études primaires seraient notées à partir de cette date sur dix points chacune, la « moyenne » étant exigée pour être admis aux épreuves orales.
Du boulier aux notes sur 20
On remarquera qu’il n’en a pas été de même lors de la mise en place de l’autre examen emblématique de la France, à savoir le baccalauréat. Dans la première moitié du XIXe siècle le jury évalue les candidats à l’aide d’un boulier, dans le cadre d’un examen oral d’une durée d’une demi-heure à trois-quarts d’heure. Rouge, l’avis est favorable ; noire, défavorable ; et blanche, le sort du candidat dépend des autres membres du jury.
C’est seulement sous le Second Empire que ce vote du jury est traduit en chiffres. L’aspirant bachelier se voit alors évalué sur une échelle de 0 à 5. La notation sur 20 apparaît en 1890, en même temps que le baccalauréat « moderne » avec plusieurs séries, et à l’écrit.
On voit que l’évaluation par des notes chiffrées (et éventuellement leurs moyennes) n’est nullement une condition nécessaire pour des examens donnant lieu à une certification dûment patentée. Cela n’a pas été le cas pour le baccalauréat pendant un demi-siècle. Et cela n’est toujours pas le cas pour l’obtention de doctorats (figurant pourtant parmi les plus hautes certifications).
Notons aussi que la mise en place en 1890 d’une notation chiffrée sur 20 au baccalauréat a suscité des réserves ou des mises en garde durant les deux décennies suivantes, même au plus haut niveau. Et certaines de ces considérations ne manquent pas encore d’intérêt aujourd’hui.
En 1900, la Direction de l’enseignement secondaire, fait le point d’une façon quelque peu embarrassée :
« C’est une chose très digne de remarque que notre pays soit le seul, ou peut s’en faut, où les compositions ont pris dans l’éducation publique la part que nous leur accordons, le seul où la notation peut se faire sur 20. Nos usages à cet égard font sourire les étrangers et leur cause plus de surprise que d’envie. Ce n’est pas une raison pour rompre avec une tradition séculaire […] Mais il faut faire en sorte d’en corriger un peu les inconvénients tout en en gardant les avantages. »
Il est encore plus significatif que Ferdinand Buisson, qui a été placé par Jules Ferry à la tête de l’enseignement primaire où il restera 17 ans) estime, à propos de la notation sur 20, dans le Nouveau dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire paru en 1911 :
« Dès qu’il s’agit des millions d’enfants de nos écoles primaires, l’émulation normale les stimule à faire effort pour obtenir l’approbation du maître sans se préoccuper de l’obtenir à l’exclusion des autres ou à un plus haut degré qu’aucun d’eux. »
À vrai dire, la sous-commission sur ce sujet, présidée par Octave Gréard avait déjà pris position dès 1900 :
« Le but à ne pas perdre de vue, c’est de corriger l’abus des comparaisons individuelles et les dangers de l’émulation surexcitée à l’excès. À cette fin, on ne saurait trop réduire, surtout pour les enfants des petites classes, l’importance du classement proprement dit. »
Mises en question
« Dans les compositions, chaque copie aura sa note chiffrée de 0 à 20 », dit l’article 21 de l’arrêté du 5 juillet 1890. Il s’agit de la première mention officielle de ce type de notation. Et elle est solidaire de la question des prix et accessits par le biais des « compositions » (trimestrielles ou non).
L’enseignement secondaire public, toujours payant, même après que les écoles communales sont devenues gratuites en 1882, était fréquenté alors presque exclusivement par la bonne bourgeoisie très friande des prix ou, à défaut, d’accessits, et de l’ostentation des remises de prix – dans un contexte de rivalité exacerbée avec les établissements privés après les lois Ferry.

Il convient donc que les prix (et les accessits qui se multiplient) soient attribués de façon incontestable, « mathématiquement », d’où des notes chiffrées qui permettent des moyennes, avec classement général, par exemple, pour l’attribution du prix d’excellence, en donnant l’impression qu’il existe en quelque sorte une unité de compte.
C’est cet ensemble (prix, compositions, notation sur 20) qui est remis en cause par le colloque d’Amiens de mars 1968 présidé par Alain Peyrefitte, puis par les dispositions prises par le ministre de l’Éducation nationale Edgar Faure dans sa circulaire du 9 janvier 1969, introduisant une évaluation exprimée par des lettres : À, B, C, D, E. Et cela réussira partiellement : les prix et les compositions (mensuelles ou trimestrielles) vont disparaître définitivement (sauf rares exceptions résiduelles). Mais la notation sur 20 dans le secondaire persistera d’abord dans les classes d’examen (officiellement à partir de 1972), puis dans l’ensemble du secondaire.
On notera que cette mise en cause a été faite quelques mois avant même Mai 68 dans un colloque tout à fait officiel où se trouvait la fine fleur des hauts fonctionnaires de l’Éducation nationale et des chercheurs en éducation. Le rapport final stigmatisait en effet
« les excès de l’individualisme qui doivent être supprimés en renonçant au principe du classement des élèves, en développant les travaux de groupe, en essayant de substituer à la note traditionnelle une appréciation qualitative et une indication de niveau (lettres A,B,C,D,E). »
Roger-François Gauthier, qui a été inspecteur général de l’administration au sein de l’Éducation nationale, pose in fine une question dérangeante : « En quoi la machine à évaluer est-elle devenue folle ? ». Dans Ce que l’Ecole devrait enseigner, il note ainsi que « le système éducatif français peut sembler idéaliser et même sacraliser les savoirs » mais
« se montre étonnamment léger […] en se fondant sur cet objet étrange et complaisant qu’est le calcul de la moyenne. Et pas seulement à l’intérieur d’une discipline, mais entre toutes les disciplines, quelques disparates qu’elles soient. La non-maîtrise d’une compétence fondamentale dans une discipline disparaît dès qu’on compense ladite discipline par une autre. »
Cela se comprend si l’essentiel, en réalité, est de classer, socioscolairement. Mais cela révèle aussi une indifférence extraordinaire, généralement inaperçue, aux acquis réels et proportionnés des élèves, à leurs maîtrises de tel(s) ou tel(s) savoir(s), savoir-faire ou savoir-être.