M’interrogeant sur la « post-vérité », ou ce qu’on appelle ainsi, j’ouvris la page Wikipédia fort documentée et anormalement longue (détaillée et passionnante) pour une notion aussi récente. Sans doute la longueur des articles du net sur le net est-elle à proportion de la contemporanéité, pour ne pas dire de l’actualité bien que les deux notions aient tendance à fusionner, du concept. Un concept encore assez mal défini, et qui fut forgé en réaction à une série d’événements politiques et géopolitiques dont le mensonge de Bush Junior à propos des armes de destruction massive en Irak est le préalable, mais dont la multiplication, de la propagande du Brexit au grand déballage de « Bullshit » de Trump sont la consécration.
Raison pour laquelle l’expression d’ère « post-vérité » a été élue « mot de l’année 2016 » par le dictionnaire d’Oxford, qui la définit ainsi :
« ce qui fait référence à des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d’influence pour modeler l’opinion publique que les appels à l’émotion et aux opinions personnelles. »
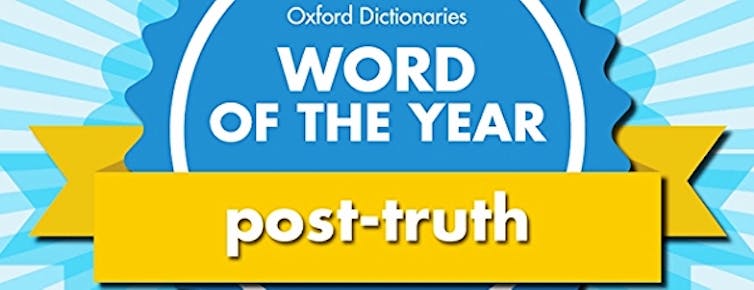
Ère post-vérité, ère de l’indifférence
Et si j’utilise le terme de « bullshit », c’est que Wikipédia me rappelle justement le titre de l’article du philosophe américain Harry Frankfurt, publié en 1986 : « De l’art de dire des conneries », où il distingue le mensonge qui s’appuie sur une reconnaissance de la vérité et la connerie qui se fiche éperdument de la simple distinction entre vérité et mensonge.
Or cette indifférence à la vérité a été très précisément analysée par Hannah Arendt dans « vérité et politique » où elle revient en philosophe sur le monde qu’Orwell avait décrit en romancier. C’est même là son point central, et je ne résiste pas à la tentation de la citer,
« … le résultat d’une substitution cohérente et totale de mensonges à la vérité de fait n’est pas que les mensonges seront maintenant acceptés comme vérité, ni que la vérité sera diffamée comme mensonge, mais que le sens par lequel nous nous orientons dans le monde réel – et la catégorie de la vérité relativement à la fausseté compte parmi les moyens mentaux de cette fin – se trouve détruit. » (« Vérité et politique », dans La crise de la culture, folio poche p. 327-328).
Autrement dit, le danger de la post-vérité n’est pas le mensonge, qui en soit peut même constituer une forme de liberté par rapport au factuel, mais bien l’indifférence à la distinction entre mensonge et vérité. Nous parlons ici de « vérité de fait », et si la prétention à la vérité peut aussi être un danger pour le politique en ce que le réel est soumis à des interprétations diverses et contradictoires, elle doit demeurer une idée régulatrice à moins de sombrer dans un parfait cynisme.

Les traces du totalitarisme
Si Hannah Arendt me semble être une source stimulante pour comprendre l’ère post-vérité, ce n’est pas seulement parce qu’elle a écrit ce texte en 1964, (et déjà, dans les Origines du totalitarismes publié en 1951 elle en faisait état) et qu’à ce titre, on peut admettre soit qu’elle était visionnaire, soit que le concept de post-vérité remonte malheureusement bien plus loin que les lubies d’un Donald Trump adossées à l’exponentielle prolifération de la rumeur et de l’opinion indépendamment de tout fact checking que représente la Toile ; la post-vérité est la vérité de tout totalitarisme, autrement dit de toute politique où l’idéologie tend à se substituer intégralement au réel.
Totalitarisme dont l’école de Francfort, et Hannah Arendt elle-même montrent que certaines de ses tendances perdurent en démocratie, du fait de la structure de masse : la masse est la condition de possibilité du régime totalitaire, elle l’est aussi du capitalisme libéral – la publicité par exemple substituant là aussi à la valeur réelle d’une chose, une simple image, et peu importe que cette image soit fausse.
Homme privé – homme public

Revenons alors à la deuxième raison pour laquelle j’en appelle à Hannah Arendt, et à sa conception de la vie privée dans son opposition à la vie publique qu’elle emprunte à la philosophie grecque – ce qu’elle expose dans la Condition de l’homme moderne, paru en 1958 ; opposition qui me semble particulièrement pertinente pour comprendre la victoire de l’ère post-vérité.
Les Grecs distinguaient la vie privée et la vie publique de façon très différente de la nôtre, qui a vu émerger le phénomène du social, dépassant, voire abolissant cette distinction : la vie privée est celle de l’homme économique, indépendamment de son inscription dans le monde humain, c’est-à-dire le monde où l’on produit du sens reconnu et manifeste, des objets, et des œuvres, et tout ce qui, étant public, transcende l’homme privé aliéné à la seule nature.
« Vivre une vie entièrement privée, c’est avant tout être privé de choses essentielles à une vie véritablement humaine : être privé de la réalité qui provient de ce que l’on est vu et entendu par autrui, être privé d’une relation “objective” avec les autres, qui provient de ce que l’on est relié aux objets communs, être privé de la possibilité d’accomplir quelque chose de plus permanent que la vie. La privation tient à l’absence des autres ; en ce qui les concerne l’homme privé n’apparaît point, c’est donc comme s’il n’existait pas. » écrit Hannah Arendt (éd. Pocket, p. 99).
Et voilà que l’homme privé est devenu tout puissant. Tout puissant, mais demeurant privé, privé de cette transcendance qui caractérise le monde humain. L’ascension de l’homme économique est allée de pair avec la destruction du monde commun et du politique tout à la fois. Or « la réalité » est étroitement liée à l’idée de monde commun comme seul lieu d’une véritable existence humaine. C’est dans cet espace-là que peut avoir encore du sens la notion de vérité de fait, dans sa relation à la réalité humaine (et non scientifique) :
« Notre sens du réel dépend entièrement de l’apparence, et donc de l’existence d’un domaine public où les choses peuvent apparaître en échappant aux ténèbres de la vie cachée ».
Et dans « apparence », il ne faut pas entendre l’apparaître dans son opposition à l’être, mais au contraire comme sa révélation.
« Pour nous l’apparence – ce qui est vu et entendu par autrui comme par nous mêmes – constitue la réalité. Comparées à la réalité que confèrent la vue et l’ouïe, les plus grandes forces de la vie intime – les passions, les pensées, les plaisirs des sens – mènent une vague existence d’ombres tant qu’elles ne sont pas transformées (arrachées au privé, désindividualisées pour ainsi dire) en objets dignes de paraître en public. (…). C’est la présence des autres voyant ce que nous voyons, entendant ce que nous entendons, qui nous assure de la réalité du monde et de nous-mêmes (…) ».

Mise en scène du « moi privé »
Mais si l’individu privé, non pas dans sa singularité mais dans son conformisme, se substitue, à travers sa duplication, et la guise de relation que constitue le réseau, au monde commun, si la structure de « masse », remplace la notion de « commun » corrélative de pluralité, alors la réalité en effet n’a plus lieu d’être, sinon à s’éparpiller en de multiples points de vue, dont la vue ne porte pas sur une réalité commune, comme le proposerait le modèle monadologique de Leibniz, mais sur le point de vue lui-même, dans un reflet à l’infini de l’œil : le point de vue qui ne reflète plus le monde, mais bien le moi privé.
Et de fait, c’est encore le moi privé que la télévision vient mettre en scène aujourd’hui, non seulement celui d’anonymes qui par ce biais deviennent ce qu’il est convenu d’appeler des « people » ou « demi-people », exposant leur intimité et déplaçant ce qui auparavant n’était pas digne d’appartenir à la sphère publique, vers ce nouvel espace, où les choses apparaissent, mais délestées de toute possibilité de transcendance.
Cet espace d’apparaître est devenu le champ du public, et de ce fait la mort du public. Le privé l’a emporté, cédant la place à l’intimité de l’homme politique au détriment de son discours – aux émotions et à la psychologie au détriment de la pensée.
À ce titre, je citerais volontiers la phrase de Guy Carcassonne, constitutionnaliste, et trouvée sur Wikipédia, tiré du papier d’Éric Aeschimann dans Libération le 14 juillet 2004 :
« À tort ou à raison, les hommes politiques ont l’impression que l’appréciation que les Français vont porter sur eux ne sera pas liée à la qualité de ce qu’ils disent, mais à la rapidité et à l’intensité de leur émotion. »
ou encore Claude Poissenot dans The Conversation du 22 novembre 2016 :
« Les individus sont désormais définis par un « moi émotionnel ». Devenir soi-même est devenu une norme. (…) Le populisme de « l’après-vérité » (est) un effet pervers de la modernité qui invite les individus à se construire eux-mêmes »
Faillite du commun, faillite du langage
L’homme privé était jadis l’esclave. Il l’est encore aujourd’hui. C’est l’esclavage qui est devenu public, et de ce fait vertu. L’aliénation à des « valeurs » qui n’ont rien de partageable en tant que valeurs communes, puisqu’elles consacrent l’individualisme – ce qui est « à moi » et non aux autres, de la richesse à l’enfance, de la femme ou des enfants à la coiffure. Bref, tout ce qui était exclu du champ du politique et du monde humain par les Grecs.
La réalité commune qui définissait le monde humain, champ de l’action et de la parole, a fait faillite : chacun a la sienne, les communautés ont les leurs, les algorithmes s’occupent de ne les faire jamais se rencontrer. Faillite de l’idée même de vrai, et de toute prétention à établir quelque chose de commun à partir du réel.
Car pour établir quelque chose de commun, encore faut-il parler le même langage : faillite donc du langage qui s’est déconnecté de sa vocation à dire, au profit d’un simple accompagnement d’émotions, et qui pourrait en réalité se réduire à des interjections ou des onomatopées, mais auxquelles on a rajouté des story tellings. Le plaisir du récit n’a pas totalement disparu.
Car si l’on est dans une ère post-vérité, c’est donc qu’on est dans une ère post-langage. Certes, déjà les sophistes usaient du langage comme d’un simple outil de pouvoir, au demeurant fort rémunérateur (cf. Les Zemmour qui en font profession et gagnent très bien leur vie, à proportion de leurs outrances – l’outrance est aujourd’hui économiquement rentable) – ce qui tendrait à relativiser le préfixe de « post ».
Il semble pourtant que le phénomène se soit accentué. Et s’il est vrai que la Raison est soumise à un perpétuel mouvement dialectique, disons que nous sommes confrontés à sa figure la plus triste, à sa fixité la plus morbide, avant qu’elle-même ne se réinvente pour se libérer de ce qu’elle est devenue : la technique autonome d’un côté, la crédulité dans la parole humaine et sa valeur de l’autre.
Platon s’était érigé contre les sophistes pour asseoir l’idée du vrai qui sauverait et le logos et la pensée ; Descartes s’était érigé contre les sceptiques pour sauver la philosophie et la science ; c’est lors de crises majeures de la vérité que la philosophie s’est refondée. On peut espérer voir surgir le nouveau héraut du « critère ».
La reconnaissance du vrai contre l’opinion

Pourtant, la société de masse semble être un phénomène nouveau au regard des millénaires passés, et rendre le différend d’autant plus irréductible : car lorsque le commun n’est plus, lorsque le moi est érigé en norme et dupliqué à l’envi, lorsque les réseaux et la toile offrent aux pulsions la possibilité d’immédiatement s’exprimer, lorsqu’il n’est plus de sanction face au mensonge puisqu’il se présente comme une opinion et que l’opinion est devenue toute puissante (le moi émotionnel étant son fondement inattaquable), puisque l’émotion elle-même n’entre pas dans le champ de la vérité ni celle du mensonge, et se dégage ainsi de tout débat pour le remplacer, dans ces conditions, qu’importe en effet la vérité ?
Ou la tentative d’ajuster ses propos à une réalité qui serait communément reconnue ? Comment résister à l’autonomie pure du discours qui se détache de ses conditions de validation ou de vérification. L’acte même de vérification est rendu caduc par l’indifférence au vrai.
Cette indifférence n’est pas universellement partagée, bien sûr, et il demeure des soldats de la reconnaissance du Vrai (parfois même fanatiques), qui vérifient incessamment, prennent des risques, recoupent leurs sources, mais la conséquence de leur action n’aura d’intérêt que pour ceux qui tiennent la vérité pour une valeur commune.
Les négationnistes ne font pas autre chose : le principe de contradiction n’a pas de prise sur eux ; la démonstration scientifique, le témoignage humain, rien ne peut les faire changer d’avis puisque leur avis relève d’une croyance, dont la clé d’intelligibilité n’est pas à chercher du côté de la passion scientifique, mais d’une passion d’un autre ordre. Le réel n’a pas de prise sur eux. Comme il n’en a pas sur les électeurs de Trump ou de Marine Le Pen.
La démocratie contre le « mensonge complet »
La vraie question devient alors : qu’est-ce que l’avenir d’une démocratie si ce que Arendt appelle la « vérité de fait » n’a plus lieu d’être ? Car « la possibilité du mensonge complet et définitif, qui était méconnu aux époques antérieures, est le danger qui naît de la manipulation des faits ».
Qu’en sera-t-il en outre pour les historiens, si
« Les chances qu’a la vérité de fait de survivre à l’assaut du pouvoir sont effectivement très minces : elle est toujours en danger d’être mise hors du monde, par des manœuvres, non seulement pour un temps, mais, virtuellement, pour toujours. » (p. 294) ; et en effet, « qu’est-ce qui empêche ces histoires, images et non-faits nouveaux de devenir un substitut adéquat de la réalité et de la factualité ? »
(Arendt, « Vérité et politique » p. 323)

