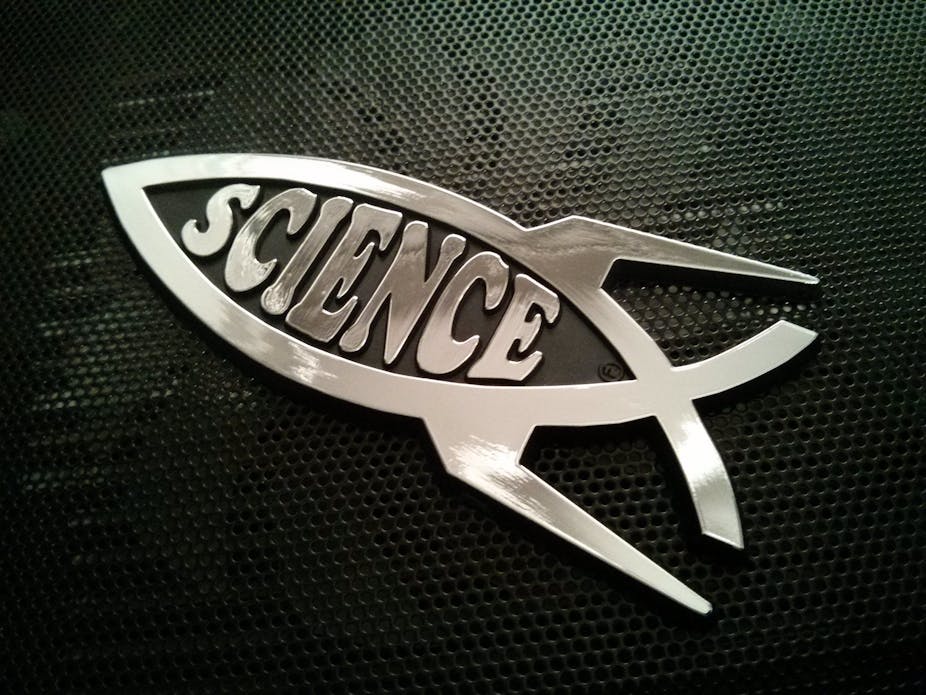Les idées fausses répertoriées par Julien Bobroff dans un article publié par The Conversation sont importantes à combattre pour engager les chercheurs dans une démarche de vulgarisation qui ne leur est pas toujours naturelle. Restent cependant à traiter quelques questions épineuses de la diffusion des savoirs : pourquoi ? pour qui ? comment ? Questions toujours débattues, mais sur lesquelles nous éclairent les meilleurs spécialistes des études des sciences, et que je traite depuis 2006 sur mon blog. En voici une sélection…
« La vulgarisation est nécessaire tant l’inculture du public est grande »
À l’origine de cette idée fausse, les chercheurs s’appuient sur l’ignorance qu’ils constatent autour d’eux ou sur les enquêtes qui interrogent à intervalles réguliers un panel de citoyens sur quelques connaissances scientifiques, comme le fait par exemple l’Eurobaromètre. C’est au mieux inutile (les scores n’ont pas bougé entre 1992 et 2001, comme sous l’effet d’un fond culturel à grande inertie) et au pire contre-productif : parce qu’un tiers des sondés ne sait pas que la Terre tourne autour du soleil alors il faudrait vulgariser des connaissances de niveau CE1-CE2 ? Quel ennui pour tout le monde, alors même que les personnes concernées se déplacent rarement à un événement de culture scientifique.
« Une technologie vulgarisée est une technologie mieux acceptée »
En général, les sachants et les gouvernants estiment qu’un peuple mieux informé prendra de meilleures décisions, c’est-à-dire celles que lui-même défend : « si on explique mieux et plus largement les nanotechnologies, alors on aura les citoyens derrière nous ». Sauf que, selon Joëlle Le Marec (« Le public dans l’enquête, au musée, et face à la recherche » dans La publicisation de la science, Presses universitaires de Grenoble, 2005) :
Il existe certes une corrélation entre le degré de méfiance envers la science, et la catégorie socioprofessionnelle, et cette corrélation a peut-être contribué à renforcer le cadre d’interprétation issu du deficit model, selon lequel ce sont les représentants des catégories les moins diplômées qui sont nécessairement les plus méfiants à l’égard du développement scientifiques et techniques. Mais Daniel Boy (1999) a souligné l’évolution très significative de cette corrélation : actuellement, les plus diplômés partagent avec les autres une méfiance vis-à-vis des retombées du développement scientifique et technique, ce qui met en cause le stéréotype de la relation de causalité entre la méfiance (associée aux fameuses peurs irrationnelles) et le degré d’ignorance.
« Il faut vulgariser pour susciter des vocations scientifiques »
C’est un objectif fréquemment rencontré, et comme l’explique la chercheuse en sciences de l’éducation (Camilla Schreiner) :
« plus un pays est développé, moins ses étudiants souhaitent devenir scientifiques ou ingénieurs. Ces disciplines ne leur apparaissent pas suffisamment importantes et significatives. Elles semblent “hors du coup” et obsolètes. Mais il est intéressant de noter que des domaines mieux côtés – comme la biologie, la médecine et les études de vétérinaire, les sciences de l’environnement – ne souffrent pas du même manque d’étudiants. Pour ces jeunes, travailler sur des défis dans les domaines de la santé ou de l’écologie a plus de sens que de se plonger dans la physique, les maths ou la technologie. »
Sur ce terrain de bataille des valeurs, il n’est pas certain que la vulgarisation soit la meilleure arme…
« On vulgarise pour les bonnes raisons »
Si ce n’est pas pour combattre l’inculture ou la méfiance, si ce n’est pas pour susciter des vocations, alors pourquoi vulgariser ? Il reste une bonne raison possible, celle qui vise à former des citoyens éclairés et critiques. Nous verrons par la suite que ce n’est pas inné dans la démarche de vulgarisation.
Osons donc une propositions iconoclaste : et si finalement la vulgarisation était surtout un prétexte à faire des activités, rencontrer du monde, échanger autour de questions et préoccupations communes – et finalement à faire société ?
Moins posé sur un piédestal, le savoir scientifique trouverait sa valeur sociale dans la curiosité, l’émerveillement et le lien social qu’il permet…
« La vulgarisation doit se concentrer sur les faits »
On attribue à Roland Barthes ce commentaire taquin : « Quand on m’explique les mathématiques, je perds pied dès le premier mot. En physique, je comprends la première phrase, en biologie j’ai compris l’essentiel du message et en sciences humaines, chacun donne son avis. » Toutes les sciences ne sont donc pas logées à la même enseigne : plus elles traitent d’objets abstraits et plus elles sont compliquées à vulgariser.
Le degré d’abstraction est un obstacle, mais aussi le formalisme et la « pureté » des lois de la discipline. La science livresque est souvent son propre ennemi, cette « empoisonnante et répétitive corvée qui consiste à frapper le pauvre dêmos indiscipliné avec le gros bâton des “lois impersonnelles” » comme la décrit le sociologue des sciences Bruno Latour (L’espoir de Pandore. Pour une version réaliste de l’activité scientifique, La Découverte, 2007). Le chercheur s’intéresse plutôt à ce qui n’est pas encore été prouvé, alors pourquoi vouloir sans arrêt y intéresser le public ?
« Le public s’intéresse seulement à ce qui a été prouvé »
Dans l’un de mes livres de vulgarisation préféré, Seed to Seed (non traduit en français), le biologiste des plantes Nicholas Harberd explique ses travaux sur les protéines mais surtout, met en avant son questionnement scientifique, sa manière propre de faire des sciences. Ceci n’est pas naturel : le chercheur rechigne à révéler son fil de pensée, tout comme le cuisinier n’aime pas montrer ses cuisines.
Sauf que quand le secret du cuisinier participe au succès de son art et ne trompe personne sur la nature du travail accompli, la pudeur du chercheur a un effet néfaste sur la réception des sciences par la société… comme l’a montré le scandale du climategate, et sur les doctorants qui réalisent douloureusement qu’« à l’opposé de toutes les images d’Épinal, qui montrent la recherche scientifique comme un archétype de travail méthodique, conquête systématique et contrôlée de l’inconnu, c’est l’errance et la contingence qui y sont la règle » (Jean‑Marc Lévy-Leblond, « Le chercheur, le crack et le cancre », dans Impasciences, Le Seuil, 2003). Le métier de chercheur n’est pas celui de guichetier ou de plombier. En tentant de faire bouger la frontière entre ce qu’on connaît et un peu d’inconnu (comme l’explique le physicien Stéphane Douady dans le film « Cherche toujours »), le chercheur possède une part d’ombre, de doute, et verse d’un côté que peu de gens ont l’occasion de côtoyer.
Parce qu’il maîtrise un sujet sur le bout des doigts, il s’abstrait malgré lui de l’expérience quotidienne de la nature et voit avec d’autres yeux le monde qui nous entoure. En état permanent d’éveil et de curiosité par rapport à ce monde, il laisse parler l’imaginaire qu’il a en lui. En ce sens, le chercheur est très proche de l’artiste, dont la vision du monde est également singulière. Mais le chercheur a une responsabilité supplémentaire, celle de nous faire entrer dans le monde qu’il participe à construire et de nous en révéler la trame.
« Il suffit de connaître la science pour vulgariser »
Comme je l’indiquais avec les camarades du groupe Traces dans notre manifeste « Revoluscience » en 2010 :
Bien des aspects de la science moderne et de ses rapports à la société ne se comprennent qu’à travers une compréhension élaborée non plus depuis « l’intérieur » de la science, mais grâce à de multiples regards disciplinaires extérieurs. Comment démêler l’histoire du 1/2climategate1/2 à l’aide de ses connaissances en sciences du climat ? Le recours aux arguments purement scientifiques est‐il meilleur que le recours à l’épistémologie pour évaluer les degrés de scientificité respectifs de la théorie de l’évolution et de l’intelligent design ? […] En d’autres termes, pour comprendre et faire comprendre les controverses, les rapports entre savoir et pouvoir, la genèse des découvertes, les changements de paradigmes, les critères de scientificité, la question de la désaffection pour les études de science et autres mouvements antiscience, le médiateur scientifique devra parfois savoir se faire vulgarisateur de la sociologie des sciences, de l’histoire et de l’épistémologie.
Et parfois même dans sa propre discipline, le chercheur peut être piégé par une méconnaissance de l’arrière-plan épistémologique de ses propres hypothèses et concepts. J’ai le souvenir d’une conférence du fameux biologiste et entomologiste Edward O. Wilson se faisant reprendre par la philosophe Gloria Origgi présente dans le public, et incapable de se positionner sur l’histoire des concepts qu’il manipulait, à commencer par l’altruisme qui fut introduit par Auguste Comte et fortement teinté de catéchisme positiviste.
« La vulgarisation est destinée au grand public »
L’un des pionniers de l’étude des modes de vulgarisation scientifique en France, Baudouin Jurdant, défend l’hypothèse selon laquelle la diffusion du savoir remplirait une fonction d’oralisation de la science profitant aussi bien au scientifique qui vulgarise qu’au public qu’il est censé informer. Il s’agirait non pas d’une dégradation du savoir pur mais du cœur même du fonctionnement de la science moderne, la condition de son existence comme culture :
Ce qui m’a mis la puce à l’oreille de cette réflexivité, c’est ce qui s’est passé un jour où, à une conférence sur la vulgarisation scientifique, on avait invité, certains d’entre vous l’ont peut-être connu, Michel Crozon. Michel Crozon est physicien des particules, grand vulgarisateur, homme tout à fait agréable et très intéressant. À la conférence, on lui a demandé « Pourquoi vulgariser ? », ce qui était le sujet même de la conférence. Et c’est lui qui était le premier interlocuteur. Et immédiatement, il a dit : « Pourquoi je vulgarise ? Voilà, c’est pour mieux comprendre ce que je fais. ». Et dans cette parole, ce qu’il exprime de façon absolument claire et évidente, c’est le désir d’une certaine réflexivité. « Pour mieux comprendre ce que je fais ». Ne soupçonnez pas Michel Crozon d’être un mauvais physicien ou un physicien qui ne comprenait pas ses formules, non, ce n’est pas du tout ça. La contrainte de parler, d’exposer, de présenter la science spécialisée dont il était porteur, à un public profane, à un public qui n’y connaît rien, c’est ça qui lui permettait à lui, de mieux comprendre ce qu’il faisait. C’est là le bénéfice que lui trouvait à vulgariser.
« Chercheurs et chercheuses sont égaux devant la vulgarisation »
Dans ses travaux ayant pour terrain la Suisse, Fabienne Crettaz Von Roten a constaté que la structure pyramidale des rétributions et des ressources dans la communauté scientifique se retrouve dans les activités de médiation : les femmes participent moins que les hommes et leurs activités de vulgarisation sont perçues comme une perte de qualité scientifique lors des procédures de nomination, alors que chez les hommes la vulgarisation est valorisée comme moyen de toucher le grand public ! Chercheurs, pensez-y la prochaine fois qu’un média vous sollicitera en lieu et place d’une collègue tout aussi experte du sujet…
« La vulgarisation par l’art ne peut pas être efficace sans vulgarisation scientifique »
Les collaborations art-science sont à la mode, mais les chercheurs les réduisent souvent à des effets si elles ne sont pas accompagnées d’une vraie médiation scientifique. Dans une étude menée au Jardin des plantes de Paris, Joanne Clavel a étudié la réception par le public d’un spectacle de danse à contenu scientifique, pour comprendre comment il en construit le sens.
Où il s’avère que le prospectus “scientifique” qui accompagne le spectacle est finalement très peu lu : les spectateurs sont surpris par le spectacle de danse qui se déroule dans les allées de la ménagerie et s’arrêtent pour y assister. Une fois leur intérêt enclenché, ils comprennent ce qu’ils voient (plus de 80 % des spectateurs ont reconnu une interprétation d’oiseaux), et ressentent des émotions assez fortes (note moyenne de 3,5 sur une échelle allant de -5 à 5). Il s’agit clairement d’une approche alternative à la transmission de connaissances : la médiation par la danse renvoie aux dimensions esthétiques et sensibles de la biologie de la conservation et pas uniquement à sa dimension cognitive classique ; mais cette approche donne des résultats également valables.