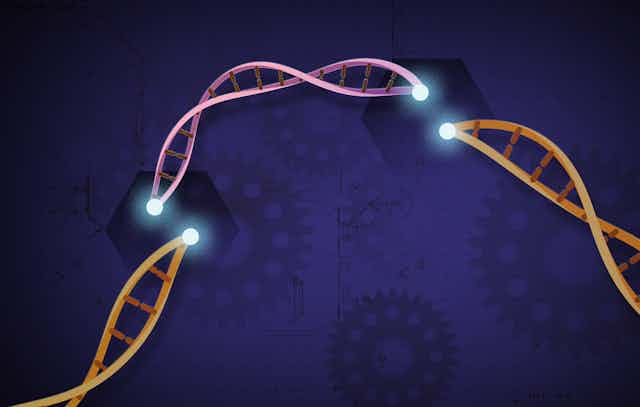Un groupe de dix-huit scientifiques de sept pays, dont la France, les États-Unis et la Chine, a publié jeudi 14 mars 2019 une tribune dans le journal scientifique Nature dans laquelle ils appellent de leurs vœux un moratoire sur l’édition du génome des cellules germinales. L’apport principal de ce moratoire est de mettre en contraste l’hétérogénéité des positions des scientifiques sur le sujet : d’une part ce que l’appel ne dit pas, et d’autre part pourquoi certaines des « stars » du milieu ne l’ont pas signé. L’onde de choc de la naissance des jumelles CRISPR, Lulu et Nana étant retombée, les positions de chacun ont eu le temps de décanter. Essayons de cartographier ces acteurs qui jouent un billard à plusieurs bandes.
Le Who’s who de l’édition du génome
L’infographie interactive ci-dessous permet de visualiser les principaux acteurs de la controverse autour de l’utilisation des nucléases chez l’humain, et de les ordonner selon différents critères : le fait d’avoir co-signé ou pas l’appel au moratoire de mars 2019, la déclaration du sommet de 2015 sur l’édition du génome humain, l’article du « Napa group » publié début 2015 appelant à prendre des précautions vis-à-vis de l’édition des cellules germinales humaines, ou encore champ académique d’origine et la langue maternelle.
L’intérêt de la comparaison mis en valeur ci-dessus est de mettre en lumière quels sont les groupes d’acteurs qui se cristallisent et s’expriment à chaque événement. Le prix Nobel David Baltimore a ainsi à la fois signé l’article de 2015 et s’est élevé dans une interview contre le récent appel à établir un moratoire.
Éditer le génome d’enfants à naître, entre recherche fondamentale et applications
Ce dernier appel (Moratorium 2019 sur l’infographie ci-dessus) vise un domaine bien précis : la réimplantation des cellules germinales (spermatozoïdes, ovules et embryons) humaines modifiées dans le but d’une conception. En l’état actuel de la science, les pistes les plus prometteuses pour réaliser ce tour de force sont les nucléases, notamment de type CRISPR.
Le contexte n’est pas anodin. Le texte utilise comme premier argument la naissance de Lulu et Nana en Chine, et le fait que des chercheurs américains qui avaient été mis au courant ont choisi de ne rien dire. Mais pourquoi demander un moratoire sur des essais cliniques alors que les expériences citées ont été jugées contraires aux règles en vigueur par les autorités chinoises, et que la plupart des déclarations académiques et politiques dans le monde sont en défaveur de toute réimplantation ?
D’autres arguments sont encore plus fragiles, comme l’idée que les déclarations institutionnelles depuis 2015 auraient minoré l’importance d’un consensus politique et social sur la question, ou encore que les intérêts en faveur de l’augmentation génétique auraient soudainement décollé. D’autres encore sont passés sous silence : certains des signataires de l’appel sont toujours dans une bataille de brevets pour savoir qui disposera de la propriété intellectuelle sur certaines des nucléases de type CRISPR, et retarder les éventuels essais cliniques sur leur utilisation in-vitro permet de neutraliser ex-ante un nouveau front de bataille juridique.
Un dispositif proposé nécessairement bancal
Les arguments en faveur d’un moratoire ne sont donc pas d’une solidité à toute épreuve, loin s’en faut. D’une part, le texte alterne entre l’usage des mots « nations » et « gouvernements », afin d’éviter le langage traditionnel des « États », entités morales capables de signer des traités et d’en faire appliquer les dispositions sur leurs territoires. Il est vrai que les exemples des conventions Unesco ou du Conseil de l’Europe sur la question, dont la convention d’Oviedo qui lie un certain nombre de pays européens et répond déjà de façon contraignante aux objectifs du moratoire demandé, n’ont pas réussi à s’imposer comme standards internationaux. D’autre part, sous prétexte de laisser les « nations » libres de construire leur modèle, il reposerait sur la bonne volonté de chaque État à s’autolimiter de façon souple, en répondant aux critères proposés par les auteurs.
Extrait de la bande annonce du documentaire « Code of the Wild ».“
L’appel au moratoire propose ainsi un dispositif reposant sur trois mesures. Après une période de blocage complet de cinq ans, tout pays qui voudrait autoriser des essais cliniques comportant une réimplantation de cellules germinales humaines modifiées devrait admettre publiquement qu’elle songe à autoriser de tels programmes pendant une durée de deux ans, puis déterminer si le type d’essais cliniques demandé répond à un besoin réel et justifié, et enfin déterminer s’il existe un consensus social suffisant pour mener à bien sereinement ces essais.
Et les auteurs de résumer l’état d’esprit de leur appel : « Le principe commun serait que toutes les nations acceptant le [moratoire] procéderaient de façon délibérée et dans le respect des opinions de l’humanité ». Le présupposé serait donc que ces étapes permettraient que « le respect des opinions de l’humanité » aille grandissant jusqu’à devenir contraignant pour tous. Peut-on supposer que la possibilité d’une modification de l’espèce humaine finirait par imposer à tous le sens de l’universel ?
Un autre chemin à construire
L’absence de nombreuses personnalités de la liste des signataires n’est pas anodine. En plus d’être de facto inapplicable, le moratoire risque de ralentir la recherche en donnant à certains acteurs sociaux, lesquels ont pu se construire antérieurement dans la lutte contre les OGM ou l’avortement, de nouvelles armes ou un nouveau terrain où combattre les sciences du vivant.
D’autres institutions, comme le comité récemment formé par l’OMS, proposent la création d’un registre central sur les recherches en cours de ce type. L’idée d’une grande base de données peut séduire, mais elle ne résout pas non plus la problématique des scientifiques et laboratoires qui décident de ne pas complètement jouer le jeu, c’est-à-dire de ne pas déclarer ou de ne déclarer que partiellement la portée de leurs recherches.
Il ne faut pas nier le fait que les cadres normatifs soient difficiles à construire. Interdire une pratique médicale dans un pays revient bien souvent à envoyer une partie de sa population y avoir recours dans un autre. De plus, les transgressions sont virtuellement impossibles à prévenir : que ce soit pour le transfert d’ADN mitochondrial ou pour CRISPR, des naissances ont eu lieu sans que les États ne puissent les empêcher, ou soient même au courant qu’elles se préparaient.
Est-il donc impossible de réguler l’usage des nucléases in vitro ? Peut-être pas. Plutôt que de porter indéfiniment le deuil des mécanismes internationaux qui ne fonctionnent pas (comme les conventions inégalement ratifiées ou appliquées comme la convention d’Oviedo, ou les juridictions internationales comme la Cour Pénale Internationale), il faut s’inspirer des mécanismes qui fonctionnent.
Agence de régulation multilatérale

Une des propositions récurrentes vient du célèbre généticien George Church, selon lequel il faudrait que les États puissent surveiller les chercheurs en génétique, par le biais d’un permis. Il utilise l’image du permis de conduire, qui certifie la capacité à conduire de façon responsable. De même, un permis de « génie génétique » permettrait de suivre les chercheurs et les industriels. Mais la comparaison atteint vite ses limites. Faut-il donner au gouvernement, donc au politique, le pouvoir d’autoriser telle ou telle recherche, de valider tel ou tel chercheur ? Disposons-nous des mécanismes démocratiques capables gérer ces enjeux ? La tendance des dernières décennies a au contraire été de confier ces pouvoirs aux autorités indépendantes expertes dans leur domaine, ou au juge, afin d’assurer une certaine stabilité du cadre juridique et de normer les pratiques.
Certaines agences de régulation, comme la FDA, ont prouvé leur capacité à s’adapter à la vitesse de l’innovation biotechnologique. D’autres, comme, en Europe, la DG Concurrence, font face aux puissances financières des multinationales et aux lobbying politique des États. Si l’uniformisation totale des essais cliniques reste un défi, l’Union européenne et les États-Unis pourraient collaborer et mettre en commun leur savoir-faire pour concevoir une agence multilatérale chargée du contrôle et du suivi des moyens nécessaires à la recherche et à l’utilisation des nucléases. Plutôt que de pister les scientifiques, il serait peut-être plus efficace de suivre et contrôler les machines.
Cela peut passer notamment par la certification et l’enregistrement des entreprises fournissant réactifs, nucléases et guides ARN ainsi que de leurs clients. De même, cela peut aussi passer par l’enregistrement des machines de séquençage ADN à haut débit dans le secteur commercial et pour la recherche. Peu de pays pourront alors se permettre de ne pas adhérer de facto aux standards d’un tel système, qui serait nécessaire à toute collaboration scientifique et industrielle.
Cela ne résout pas toutes les éventualités. Il serait toujours possible pour un pays de développer une autonomie complète en la matière en vue de remplir ses propres objectifs nationaux. Nulle autorité n’aurait alors a priori les capacités d’intervention pour contrer ces développements, mais il reste à l’heure actuelle difficile d’imaginer qu’un pays aurait intérêt à s’engager seul dans cette voie.