Le temps que nous employons à regarder des séries a quelque chose de vertigineux : Squid Game totalise à elle seule 2,2 milliards d’heures passées sur Netflix ; un sériephile modéré, qui aurait simplement vu les dix séries les mieux notées sur Senscritique (Game of Thrones, Breaking Bad, The Wire, The Walking Dead, True Detective, Dexter, Friends, Les Soprano, Six Feet Under et House of Cards) y aurait consacré 18 jours, 11h et 24 minutes. Ce phénomène particulier gagne évidemment à être pensé à l’intérieur d’une dynamique plus générale, celle de l’augmentation importante du temps d’écran.
Tout phénomène social répond à une pluralité de causes, qu’il faut identifier, puis hiérarchiser. Pour rendre compte de la popularité des séries, les universitaires ont ainsi fait appel à des explications causales de différents types, que je propose de réunir ici en trois catégories : esthétique (avec une focalisation sur la qualité des œuvres, l’économie narrative spécifique au genre sériel, l’expérience du spectateur, etc.), sociopolitique (avec une insistance cette fois sur la valeur critique et émancipatrice des séries, leur capacité à produire du lien social, ou à l’inverse sur la fonction qu’elles assurent à l’intérieur de l’économie marchande) et, enfin, psychologique (où l’explication se fonde davantage sur la valeur divertissante, thérapeutique, compensatoire, etc., que peuvent avoir les séries pour l’individu).
Parmi ces trois types, on trouvera bien sûr des explications causales plus ou moins convaincantes. Néanmoins, chacune de ces approches se défend, et contribue à accroître la compréhension de notre attachement à la fiction sérielle.
Faire passer le temps
Dans cet article, je voudrais proposer une autre explication, qui n’apparaît pas dans la littérature scientifique portant sur les séries, alors même qu’on pourrait la considérer comme transversale à ces trois catégories. Je crois que cette explication est à même de renforcer notre intelligence des différentes causes à l’origine de la diffusion extraordinaire de la forme-série dans notre quotidien. La voici : les séries font passer le temps. Elles le font mieux que tout autre produit culturel. Par leur quantité, leur durée, la diversité des thèmes qui y sont abordés (souvent avec une relative profondeur, à l’inverse d’un fil d’actualités sur un réseau social), ou encore par leur rythme, elles constituent le passe-temps privilégié du XXIe siècle.
On objectera immédiatement : n’est-ce pas le propre de toute activité que de faire passer le temps ? Sans doute, mais comme le faisait déjà remarquer le philosophe allemand Günther Anders en 1956, le fait que le temps s’écoule – parfois sans même que l’on s’en rende compte – n’est d’ordinaire que la conséquence de l’activité et non son but. Or, dans L’Obsolescence de l’homme, Anders démontrait que le développement de la société consumériste s’accompagnait de la croissance d’activités de loisir dont la fonction primordiale (et non l’effet collatéral) était de relancer le cours du temps après une journée de travail : écouter la radio ou regarder la télévision.
L’explication qu’il donne est fondée sur le travail, mais vaudrait tout aussi bien pour l’écosystème numérique dans lequel nous vivons désormais : nous avons tant été habitués à « être » occupés, c’est-à-dire à ne pas avoir nous-mêmes la responsabilité de décider de ce à quoi l’on consacre notre temps que, lorsque nous faisons face à cette responsabilité durant notre « temps libre », nous ne pouvons manquer d’éprouver une forme d’angoisse. L’expérience du temps libre serait à ce titre indissociable de l’expérience d’un vide tout à fait spécifique : il est l’envers de ce « plein » que constitue la journée de travail, et devrait en toute rigueur moins être qualifié de « vide » que de « plein qui a été vidé », et qui réclame par conséquent d’être rempli. Par quoi ? N’importe quelle activité susceptible d’occuper l’individu, de rythmer son temps, et de lui permettre d’éviter l’ennui. C’est de cette manière qu’Anders expliquait « la demande de produits de consommation pouvant être consommés de façon continue, sans risquer le moins du monde de rassasier le consommateur ».
À la lumière de cette analyse, on ne sera pas surpris d’apprendre que, lors du confinement, Netflix est parvenu à séduire 15,8 millions de nouveaux abonnés, contre 9,6 millions sur la même période l’année précédente. Netflix a su conjurer cette angoisse dont parle Anders, celle-là même qui naît de l’espace de liberté résultant du loisir ; la plate-forme de VOD (vidéo à la demande) a su remplir un temps dont nous ne savions que faire.
Séquencer le temps
Que l’être humain ne puisse faire face à un temps qui n’avance pas ou plus, et soit prêt à pratiquer n’importe quelle activité capable de remettre le temps en mouvement, c’est encore ce que l’écrivain et dramaturge Samuel Beckett montrait dans En attendant Godot, lorsqu’il mettait en scène un personnage résolu à effectuer une activité absurde (enlever sa chaussette, pour la remettre immédiatement) afin d’éviter de patauger dans la « bouillie » du temps.
[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]
Seulement, la différence entre ce strip-tease insensé et le visionnage d’une série doit ici être marquée : si ce sont bel et bien des « passe-temps » au sens que l’on a donné à ce terme, le second possède sur le premier un avantage considérable. La série, en effet, ne se contente pas de faire avancer le temps – comme peut le permettre une séance de scrolling sur son smartphone, pour tuer le temps dans les transports en commun.
Par la puissance de la fiction, et via le déploiement d’une multitude d’arcs narratifs, elle confère en outre un ordre, une forme, à ce temps qu’elle remplit. Il est ainsi possible de compléter l’hypothèse initiale, en disant : si l’on regarde tant de séries, ce n’est pas simplement parce qu’elles font passer le temps ; c’est aussi parce qu’elles contribuent à le séquencer. Et sans doute ce séquençage, sur un temps long, offre-t-il pour le consommateur un contraste plaisant avec le reste de l’offre de divertissements (jeux, réseaux sociaux, médias, etc.), qui favorisent davantage une expérience morcelée du temps.
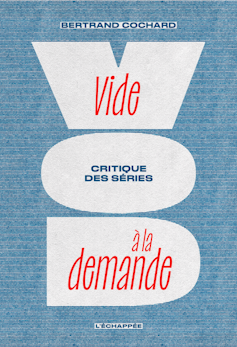
De quoi ce besoin de séquençage est-il le symptôme ? Comme l’a montré Hartmut Rosa, le temps s’accélère. Cette accélération se traduit par une compression de toutes les durées. En d’autres termes : de ce que disait le sociologue Richard Sennett du travail moderne, à savoir qu’il était émietté, constitué d’épisodes et de fragments – « dans la nouvelle économie, indiquait-il, l’expérience dominante est celle de la dérive de lieu en lieu, de job en job » –, il faudrait désormais le dire des relations sociales, des modes de consommation, ou même de la situation politique.
Le temps individuel et collectif manque cruellement de forme, tant son accélération, sur fond de crise climatique, donne lieu à des séquences d’événements brèves et insignifiantes (un scandale, une catastrophe ou un buzz venant se chasser les uns les autres). La force des séries est de ramener, dans le temps du loisir, cette forme de l’histoire (progrès, irréversibilité, sens, etc.) dont l’histoire en tant que telle est aujourd’hui dépourvue. Elles sont le passe-temps consolateur d’une époque anhistorique, symptôme d’une histoire qui ne subsiste plus guère que sur un mode spectaculaire.
Bertrand Cochard est l’auteur de « Vide à la demande, Critique des séries », paru aux éditions L’Echappée.

