Le Premier ministre a récemment annoncé vouloir restaurer l’autorité de l’État et enseigner aux (jeunes) Français son respect. Sans juger le fond de cette politique, il est permis de craindre qu’il ne fasse, avec son entourage, un contresens sur le concept et le confonde avec une notion lexicalement proche, mais conceptuellement opposée, celle d’autoritarisme. J’ai exploré cette distinction dans un travail de recherche récent.
Ils ne sont pas les seuls à commettre cette erreur. En effet, des sociologues et des psychologues sociaux confondent généralement autorité et pouvoir. Plus précisément, ils associent indifféremment l’idée d’autorité à celle de pouvoir légitime et à celle de concession ou d’autorisation. Cette confusion est parfois sans conséquence, car certains décideurs agissent à bon escient sans être autorisés à le faire. Cependant, s’ils recherchent l’autorité au sens d’autorisation, ces mêmes décideurs doivent en référer à ceux qui les entourent car ils ne peuvent pas s’autoriser eux-mêmes.
Plus généralement, l’exercice du pouvoir ne peut se faire sans affecter d’autres personnes, qui en apprécient alors ses conséquences et évaluent leur désirabilité et acceptabilité. Cette évaluation établit l’inséparabilité, à la fois théorique et pratique, du pouvoir et de l’autorité. Cependant, cela ne signifie pas que les deux notions puissent être confondues.
Une source de pouvoir, parmi d’autres
Le philosophe Carl Friedrich (1901-1984), qui fait notamment partie des grands analystes des régimes totalitaires, est l’un des premiers à s’être opposé à l’amalgame entre pouvoir et autorité et à déplorer la confusion qui en résultait. Selon lui, l’autorité se distingue du pouvoir par la nature de l’obéissance qu’elle implique : obéissance volontaire (qui indique la coopération) pour la première, obéissance involontaire (qui signale la coercition) pour l’autre.
Friedrich regrettait particulièrement que le mot « autorité » soit souvent utilisé dans un sens défavorable, dans le sens où être autoritaire serait un aspect négatif de la personnalité ou du style des individus. En effet, « autoritaire » ne désigne pas quelqu’un qui possède de l’autorité, mais plutôt quelqu’un qui prétend en avoir.
Friedrich concevait l’autorité comme une qualité précise d’une communication, celle d’avoir été élaborée raisonnablement. Une telle élaboration raisonnée (ou raisonnable) se fait selon les valeurs, les croyances, les intérêts et les besoins de la communauté au sein de laquelle l’autorité opère. En ce sens, une demande formulée dans une relation d’autorité est acceptée lorsqu’elle est reconnue comme étant étayée par des raisonnements et des justifications qui rendent son contenu souhaitable.
Cette exigence s’applique normalement à tout détenteur de pouvoir : il doit justifier ses demandes s’il veut rendre leur contenu désirable et par la même acceptable. Cependant, une différence cruciale est que les individus détenteurs de pouvoir ont la possibilité d’imposer l’obéissance sans produire une élaboration raisonnée.
Comprise au sens de Friedrich, l’autorité est accordée par ceux à qui elle s’applique. Elle est donc une source de pouvoir plutôt qu’une forme de pouvoir. C’est une qualité de la manière de communiquer qui renforce le pouvoir mais qui n’est pas elle-même le pouvoir. Pour avoir de l’autorité, le détenteur de pouvoir doit fournir des raisons convaincantes soutenant ses décisions.
Autorité n’est pas droit à diriger
L’analyse de Friedrich permet de comprendre pourquoi les décideurs qui ont « perdu leur autorité » ont perdu une forme de leur pouvoir : c’est car le contenu de leurs communications s’est dégradé. De telles situations surviennent lorsqu’ils cessent de proposer des élaborations raisonnées de leurs communications ou parce que les valeurs de la communauté à qui ils s’adressent ont changé, ce qui rend leurs arguments moins convaincants.
Dans les entreprises comme dans la sphère publique, considérer l’autorité exclusivement comme une forme de pouvoir a pour conséquence de limiter son attribution aux décideurs, comme si eux seuls pouvaient avoir de l’autorité. De plus, confondre autorité et pouvoir implique que les experts ne sont pas des autorités dans leurs domaines.
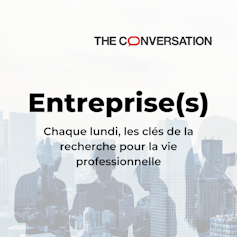
Chaque lundi, que vous soyez dirigeants en quête de stratégies ou salariés qui s’interrogent sur les choix de leur hiérarchie, recevez dans votre boîte mail les clés de la recherche pour la vie professionnelle et les conseils de nos experts dans notre newsletter thématique « Entreprise(s) ».
Alors que le pouvoir des décideurs désigne leur droit à diriger, reconnaître des individus comme faisant autorité en raison de leurs connaissances ou compétences particulières n’implique pas qu’ils aient le droit d’émettre des instructions. Il est donc possible, sans remettre en cause ni les uns, ni les autres, d’opérer une distinction entre, d’une part, les décideurs en tant que détenteurs du pouvoir légitime et, d’autre part, les citoyens, salariés, experts et autres professionnels en tant qu’autorités dans des domaines précis.
En fin de compte, confondre autorité et pouvoir (même sous sa forme légitime), c’est favoriser l’autoritarisme car c’est aider le décideur à accaparer le pouvoir, sans considération pour l’autorité du savoir-faire, de la compétence technique et de l’expertise de ceux qui font ou qui savent faire. Le détenteur du pouvoir autoritaire décide alors de tout, même des sujets sur lesquels il n’a pas d’autorité, c’est-à-dire ceux à propos desquels il n’est pas capable de proposer une élaboration raisonnable. L’arbitraire règne alors, puisque les décisions y sont prises sans être raisonnablement élaborées. De plus, le décideur autoritaire ne recherche pas le dialogue et la confrontation des points de vue, car de tels échanges reviennent à un partage tacite, même si partiel, du pouvoir.
L’objectif du Premier ministre de vouloir « rétablir l’autorité » passe donc en premier lieu par la restauration des conditions du dialogue construit, un dialogue qui prenne en compte l’expertise de ceux qui font et qui savent faire, même s’ils ne décident pas. La crise de l’autorité, c’est ainsi surtout la crise du crédit de la parole et du débat.

