Le 26 avril 1986, le cœur du réacteur numéro quatre de la centrale nucléaire de Tchernobyl dans le nord de l’Ukraine entrait en fusion avant d’exploser. La catastrophe nucléaire qui s’ensuivit allait avoir d’immenses conséquences – environnementales, bien sûr, mais aussi politiques. Pour bon nombre d’observateurs, cette tragédie a précipité l’effondrement de l’URSS en 1991.
Comment vivaient les quelque 50 000 habitants de Pripiat, ville construite en 1970 pour héberger les employés de la centrale (située à moins de trois kilomètres) et leurs familles ? À quoi ressemblaient leurs logements, leurs espaces publics, leurs loisirs ? Ce questionnement original, qui nous plonge dans la réalité sociale, économique, politique et culturelle de l’URSS finissante, est celle de l’ouvrage 24 heures de la vie à Tchernobyl de Laurent Coumel (INALCO), qui vient de paraître aux PUF, et dont nous vous présentons ici un extrait issu du chapitre « Dormir ou veiller : des lumières dans la nuit à Pripiat ».
Après le 26 avril 1986, Pripiat a été totalement évacuée et reste à ce jour une ville fantôme, abandonnée par les humains (l’accès y est interdit), envahie par la végétation, où le degré de radioactivité demeure élevé. Prise par les forces russes au début de la guerre, en février 2022, elle a été reprise fin mars par l’armée ukrainienne et est depuis retournée à la torpeur qui y règne depuis 38 ans.
[…]
Pour s’endormir, ou au contraire se tenir éveillé, on pouvait aussi choisir un ouvrage ou une brochure sur le « progrès scientifico-technique ». Cette dernière expression était au cœur du renouvellement du projet soviétique depuis la fin des années 1950, suite à la conquête spatiale qui avait vu l’URSS damer le pion aux États-Unis, avec la mise sur orbite du premier satellite artificiel en octobre 1957, puis le premier vol habité de l’histoire en avril 1961. Des représentations de mondes futuristes, où les technologies permettraient à l’humanité de dépasser ses limites, abondaient dans la littérature, les magazines destinés à la jeunesse surtout, mais aussi le cinéma, la télévision et même le paysage urbain soviétiques.
Ainsi, à quelques kilomètres de Pripiat, on trouvait sur le mur du centre de contrôle de la base militaire secrète « Tchernobyl-2 » – un ZATO (Zakrytoe administrativno-territorialnoe obrazovanie, c’est-à-dire litéralement entité administrativo-territoriale fermée) totalement fermé aux personnes extérieures, qui accueillait quelques centaines de militaires chargés de faire fonctionner l’antenne de réception Douga 1, destinée à détecter les missiles intercontinentaux lancés depuis les États-Unis –, une fresque en couleurs représentant un chantier de construction dans l’espace, où des cosmonautes pilotaient des engins à propulsion autonome dignes de Star Wars.

Les membres de l’intelligentsia scientifique et technique lisaient d’ailleurs beaucoup de science-fiction, genre qui avait ressurgi à la faveur du Dégel, surtout après le XXe congrès du PCUS en février 1956, lorsque Khrouchtchev avait dénoncé de façon semi-publique certains crimes de Staline, et orienté le pays sur la voie d’une « coexistence pacifique » faite de compétition dans tous les domaines avec l’Ouest, autrement dit les pays capitalistes d’Europe et d’Amérique du Nord. Le roman La Nébuleuse d’Andromède d’Ivan Efremov (1957), maintes fois réédité, décrivit alors les problèmes du communisme à venir, et plusieurs grands écrivains étrangers de science-fiction furent alors traduits et publiés en URSS. Parmi eux figuraient ceux de l’auteur polonais Stanislas Lem, dont le roman Solaris, paru en russe en 1962, avait inspiré le film éponyme d’Andreï Tarkovski, sorti sur les écrans en 1972, qui lui valut le grand prix du festival de Cannes cette année-là.
Plus populaires encore étaient les récits des frères Arcadi et Boris Strougatski, qui avaient mis en commun leurs compétences, de traducteur militaire pour le premier, d’astrophysicien pour le second, à partir de 1958, pour décrire, sur un ton tantôt pessimiste, tantôt humoristique, des mondes du futur ou parallèles. Il est difficile d’être un dieu (1964) raconte comment un agent secret sous couverture explore, dans le futur, la civilisation d’une autre planète figée dans une époque semblable au Moyen Âge. Lundi commence samedi (1965) dépeint la vie d’un informaticien embauché par un « Institut de recherche scientifique de Sorcellerie et de Magie », dont l’acronyme Niitchavo évoque l’adverbe nitchevo, « ça ne fait rien ». Ces textes, en raison de leur caractère partiellement subversif aux yeux de la censure, étaient difficiles à se procurer. Le roman des Strougatski Pique-nique sur le bord du chemin, publié dans la revue Aurore (Avrora) en 1972, puis sous forme de livre en 1980, avec quelques changements dans le texte exigés par les autorités, venait d’être réédité en 1984, il le sera encore en 1985, preuve de son succès.
Il racontait l’histoire d’une région de la terre, la « Zone », transformée par le passage d’extra-terrestres ayant laissé derrière eux des déchets occasionnant des ruptures dans l’ordre naturel et logique, où des guides, les « stalkers », se déplaçaient pour récolter certains objets susceptibles d’être revendus ou utilisés à l’extérieur de la Zone, non sans risques pour eux et pour leurs proches. Il servit de base à un autre film de Tarkovski, Stalker (1979) aux accents pessimistes, dont la diffusion limitée en URSS n’empêcha pas une reconnaissance internationale, y compris un autre prix au Festival de Cannes en 1980. Le terme stalker (stalker en russe) fut employé pour désigner les maraudeurs visitant clandestinement la zone d’exclusion établie autour de Tchernobyl en mai 1986, à partir des années 1990. Un jeu vidéo du même nom parut en 2007 sur le marché mondial, développé par la firme ukrainienne GSC Game World.
[…]
Les cassettes audio avaient commencé dans les années 1970 à supplanter les bandes magnétiques, bien moins pratiques : ce changement de matériel s’était accompagné d’une expansion sans précédent des capacités de diffusion des œuvres sonores, puisque désormais un simple lecteur à double cassette permettait de reproduire de façon illimitée (à condition de disposer de cassettes vierges) tout enregistrement. Ce support, parfois nommé magnitizdat en référence au samizdat, démultipliait pour la jeunesse les canaux d’ouverture sur l’étranger, même si le prix élevé des appareils limitait encore leur démocratisation à certains milieux privilégiés.
Les années 1970 virent donc l’irruption massive de la musique occidentale dans les foyers soviétiques urbains, même si elle restait très minoritaire dans un paysage sonore dominé par les artistes de variété ou « estrade » soviétique, et de la « chanson d’auteur ». La première était incarnée par des vedettes comme Alla Pougatcheva (Pougatchiova), qui en 1986 avait déjà vendu 200 millions de disques en URSS, et se produisait à l’étranger, surtout dans le bloc de l’Est mais pas seulement. Quant au mouvement des « bardes » qui incarnaient la seconde, il était devenu un phénomène de masse dans les années du Dégel, quand étaient nés des « clubs de chanson amateur » (klouby samodeyatelnoï pesni), le plus souvent adossés à des instituts de recherche ou à des établissements d’enseignement supérieur, en rapport avec le développement du tourisme_ (_tourizm). Ce loisir correspondait aux randonnées ou excursions à pied ou en canoë dans la nature sauvage, notamment en montagne et en forêt.
Une des figures les plus connues de ce mouvement était Vladimir Vyssotski, vedette à la frontière entre le star-system officiel et la culture qu’on pourrait qualifier d’underground, qui comprenait entre autres le folklore des prisons et des camps du Goulag dont il s’inspirait. Vyssotski, « non-conformiste intégré » pour la sociologue Ioulia Zaretskaïa-Balsente, était devenu célèbre comme acteur de théâtre, puis de cinéma et de télévision, avant de défrayer la chronique à l’étranger en épousant l’actrice française Marina Vlady.
Si le KGB surveillait ses concerts et s’efforçait de limiter sa popularité dans le pays, ne laissant pas diffuser en URSS ses disques pourtant exportés en Europe occidentale, il le laissait voyager librement, y compris aux États-Unis où le chanteur fit en 1979 des concerts publics. Il ne put non plus s’opposer aux hommages du monde artistique après sa mort brutale en 1980. Certains « bardes » avaient dû émigrer sous la pression des autorités, tel Alexandre Galitch ; d’autres, aux textes moins critiques, pouvaient se produire en URSS, tels Boulat Okoudjava ou Tatiana et Sergueï Nikitine.
À cette époque, les « places dansantes », qui avaient existé depuis les années 1920, furent détrônées dans la jeunesse citadine par des « discothèques » organisées par le Komsomol dans des lieux dédiés, voire des bâtiments scolaires ou universitaires, en plus des salles de bal de certains restaurants et cafés des grandes villes. Les autorités voulurent mettre un frein à l’influence occidentale : sous Tchernenko, le KGB établit, en 1984-1985 des listes de groupes à bannir des « discothèques », comme du répertoire des concerts des « ensembles vocaux et instrumentaux », terme qui désignait alors tout groupe musical. Mais ces interdictions ne furent pas vraiment respectées, car il importait d’attirer du public pour « remplir le plan ». Sous les boules à facettes, on tolérait quelques entorses aux prescriptions du Parti et du Komsomol.
Dans ces listes figuraient aussi des noms de groupes soviétiques, qui, pour leur part, avaient à subir davantage la censure sonore, même si à Leningrad, un « club de rock » avait ouvert ses portes en 1981, une première dans le pays. S’y produisaient les artistes des groupes membres de l’association qui le gérait, en accord avec les autorités ; à partir de 1983, un festival y avait lieu tous les ans, permettant à de jeunes talents de s’y exprimer.
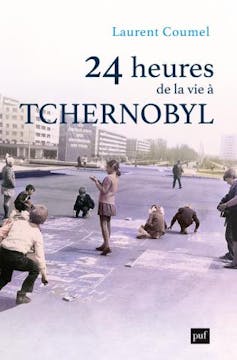
C’est là que le groupe Kino, fondé en 1981 par Viktor Tsoï, fit ses débuts sur scène, alors que des studios semi-légaux lui permettaient d’enregistrer des albums, diffusés par la fabrication clandestine de cassettes audio. Quatre albums furent enregistrés entre 1982 et 1985 par le groupe, avant la sortie de leur premier album officiel, distribué par la firme Melodiya, en janvier 1986. En 1984, à Omsk, grande ville située à 600 kilomètres à l’ouest de Novossibirsk, à la marge de la Sibérie occidentale, était né le groupe Grajdanskaïa oborona (« Défense civile ») qui se limita, en raison du caractère subversif des paroles de ses morceaux, aux concerts en appartement, c’est-à-dire à domicile, pour un public d’initiés.

