Depuis la crise de 2008, l’idée selon laquelle les banques centrales peuvent se limiter à des interventions monétaires dépolitisées a complètement été remise en cause. Les politiques de taux zéro adoptées dans les pays développés à la suite de la crise financière de 2008, mais surtout les pratiques non conventionnelles dites de « quantitative easing » (« assouplissement quantitatif ») ont permis aux banquiers centraux d’intervenir directement au sein des marchés financiers et les ont transformés en véritables acteurs politiques.
Dans ce texte, extrait de Déclin et chute du néolibéralisme (De Boeck Supérieur, 2022), l’économiste David Cayla étudie le renouveau des théories monétaires dans le monde académique. Il s’interroge sur l’affaiblissement de la pensée monétariste développée dans les années 1960 par Milton Friedman et Anna Schwartz et sur les difficultés des approches hétérodoxes à s’imposer. Selon lui, le problème réside dans la difficulté qu’elles rencontrent à concevoir un cadre économique plus général sur lequel s’appuyer.
Depuis quelques années, les questions monétaires ont été remises sur le devant de la scène par de nombreux chercheurs. C’est une conséquence de la crise financière. Avec la faillite de Lehman Brothers, en septembre 2008, les économistes se sont trouvés confrontés à un évènement de « crise systémique », une situation théorique qui ne s’était encore jamais produite à une telle échelle.
L’apparition des cryptomonnaies ou le développement des monnaies complémentaires locales ont montré que la nature de la monnaie pouvait être questionnée et que d’autres mécanismes de paiement ou d’épargne pouvaient apparaitre et concurrencer les systèmes bancaires traditionnels. Plus largement, le monde académique prit conscience, dans les années 2010, que les systèmes monétaires soulevaient de nombreuses questions qui avaient été négligées par la pensée monétariste.
Au sein des économistes hétérodoxes, ce regain d’intérêt intellectuel pour les questions monétaires prit la forme d’une nouvelle approche, la « théorie monétaire moderne » soit, en version originale, la « modern monetary theory » (MMT).
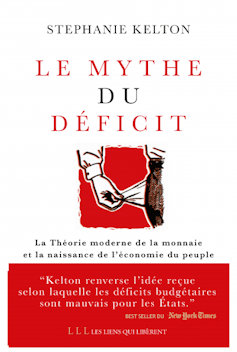
Telle qu’elle est formulée par l’économiste américaine Stephanie Kelton dans Le Mythe du déficit, paru en 2021, la MMT relève davantage d’une nouvelle façon de présenter la relation entre État et monnaie que d’une théorie originale. Pour la présenter brièvement, cette approche repose sur deux grands principes. Le premier est que la monnaie contemporaine n’étant plus indexée sur un actif réel tel que l’or, il n’y a plus de limite au pouvoir de création monétaire. Le second principe est que l’émetteur exclusif de cette monnaie est la banque centrale, c’est-à-dire l’État. Il résulte de ces deux principes qu’un État ne peut faire faillite et qu’il n’a pas besoin de trouver des recettes pour couvrir ses dépenses puisqu’il peut se financer lui-même via sa propre banque centrale.
Dès le début de son ouvrage, Kelton précise toutefois que sa théorie n’est valable que pour les États monétairement souverains, c’est-à-dire qui sont essentiellement financés par de l’épargne domestique, ce qui exclut les pays en voie de développement dont les systèmes financiers sont dépendants de l’extérieur et les pays de la zone euro. Elle précise également qu’affirmer que l’État peut se financer lui-même sans limite ne signifie pas qu’il n’y aurait aucune contrainte à la dépense publique. Seulement, cette limite n’est pas financière mais réelle. En effet, si un État dépense trop, il détourne des emplois et des ressources de la sphère privée vers la sphère publique, ce qui peut avoir pour effet de diminuer la disponibilité de l’offre marchande et des biens de consommation.
Réhabiliter la dépense publique
Lorsqu’on va au bout de la logique de la MMT, on comprend que la dette et les déficits publics n’ont pas l’importance qu’on leur accorde dans le débat public. La dette publique, explique Kelton, n’est pas d’une nature profondément différente de la monnaie publique. C’est seulement une forme de monnaie qui rapporte des intérêts à son détenteur.
La MMT renverse la logique et les raisonnements monétaristes. Elle affirme que ce n’est pas la politique monétaire qui est à l’origine de l’inflation mais la politique budgétaire ; que le problème n’est pas tant l’accroissement de la masse monétaire que la raréfaction de l’offre de marchandises. De même, l’effet d’éviction entre les secteurs public et privé ne relèverait pas d’un problème financier, mais de l’économie réelle. En effet, du point de vue de la MMT, tant qu’il y a des chômeurs à employer, la dépense publique ne risque pas de se faire au détriment du secteur privé puisque l’existence du chômage démontre que des ressources productives disponibles n’ont pas été utilisées par le secteur marchand.
[Près de 80 000 lecteurs font confiance à la newsletter de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd'hui]
Finalement, ce que permet la MMT c’est surtout de réhabiliter la politique budgétaire et de montrer l’importance des interventions discrétionnaires publiques dans l’économie. Ainsi, à l’opposé des principes monétaristes, Kelton défend l’utilité de l’interventionnisme et affirme la nécessité de piloter politiquement l’économie.
Une approche théorique incomplète
Si les propositions de la MMT sont intellectuellement stimulantes dans leur manière de renverser la logique monétariste, elles ne font pas l’unanimité, y compris parmi ceux qui sont opposés aux monétaristes. Ainsi, l’économiste keynésien Henri Sterdyniak, membre du collectif des Économistes atterrés, en fait une analyse critique intéressante sur son blog. Selon lui, Stephanie Kelton omet de préciser que sa théorie n’est valable qu’en période de sous-emploi.
De plus, il apparait très compliqué d’utiliser l’emploi public comme un mécanisme de stabilisation du chômage. Cela supposerait qu’on recrute en période de sous-emploi, mais qu’en période de plein-emploi et de tension inflationniste, l’État devrait se séparer d’une partie des personnes embauchées précédemment afin de permettre au secteur privé de les recruter.
Plus fondamentalement, Sterdyniak note que la vision proposée par Kelton est incomplète. En premier lieu, en se focalisant sur le rôle de la banque centrale en tant qu’institution émettrice de monnaie, elle oublie le rôle pourtant central des banques et du crédit bancaire dans le processus de création monétaire. De même, le rôle des marchés financiers et les contraintes liées à la mondialisation sont sous-estimés.
Enfin, la dernière limite de la MMT concerne le souverainisme monétaire. Kelton le pose comme principe de sa théorie, mais elle n’en explique pas toutes les conditions. La tâche fondamentale incombant à la MMT ne devrait pas être de résoudre des problèmes de financement public dont elle affirme qu’ils n’existent pas. Elle devrait être d’expliquer comment créer les conditions d’une véritable souveraineté monétaire dans tout pays dont la monnaie n’est pas le dollar américain. Cette tâche est théoriquement simple, mais pratiquement très délicate. Il faudrait limiter le taux d’ouverture des économies, c’est-à-dire instaurer des politiques protectionnistes pour diminuer les échanges commerciaux avec l’étranger et produire davantage localement.
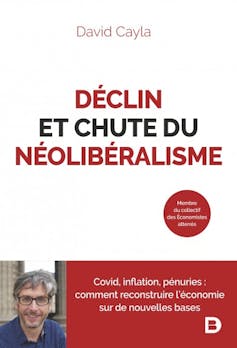
Il faudrait aussi instaurer un contrôle des changes pour éviter toute fuite des capitaux et orienter prioritairement l’épargne nationale vers des investissements intérieurs. Il faudrait, en somme, démondialiser, isoler en partie les économies des circuits commerciaux et financiers internationaux. Sans un relatif isolement économique, il est difficile de faire de la MMT une solution praticable pour la plupart des pays.
Ce qu’il faut retenir de ce qui précède n’est pas que la MMT serait sans intérêt pratique ou théorique, mais plutôt qu’elle ne constitue pas une réponse magique qui permettrait de résoudre par miracle toutes les difficultés économiques d’un pays. Elle n’est, en vérité, qu’une réponse partielle qui suppose des conditions tout à fait particulières pour être mise en œuvre. C’est d’ailleurs le cas de toutes les politiques alternatives au monétarisme. Aucune n’est entièrement satisfaisante. Toutes manquent, pour être vraiment opérationnelles et crédibles, d’un élément dont seul le monétarisme dispose : une relation symbiotique avec le mode de fonctionnement général de la société.
Le poids des institutions
Une politique n’est réellement praticable que si elle est menée dans un cadre institutionnel adapté, c’est-à-dire si elle est cohérente avec l’ensemble des règles formelles et informelles qui participent à l’organisation des comportements sociaux.
Le rôle des institutions est d’organiser la coordination des comportements dans la durée. Les institutions sont premières. Elles définissent les limites et les conditions de tous les comportements possibles. Les individus choisissent par la suite leurs comportements dans le cadre et les limites ainsi posées.
La pensée néolibérale est non seulement inscrite dans les institutions formelles, c’est-à-dire dans les textes de loi, dans les constitutions et le fonctionnement de certaines administrations, mais elle est encore plus fortement incrustée dans les habitudes, les représentations et les idéologies.
Le problème avec les politiques alternatives qui entendent rompre avec le monétarisme, c’est que ceux qui les ont conçues n’ont pas de théorie globale leur permettant de comprendre le fonctionnement des institutions. De ce fait, ils ne parviennent ni à articuler leurs propositions dans le cadre actuel ni à proposer un discours clair sur la manière de transformer ce cadre pour rendre leurs politiques possibles.link text
Le monétarisme : un élément du système néolibéral
La grande force idéologique des néolibéraux vient du fait qu’ils ont pensé les institutions, et que leur pensée inclut non seulement des réflexions sur le cadre légal et formel au sein duquel les marchés doivent fonctionner, mais qu’ils sont également parvenus à changer en profondeur les manières de voir, les idéologies et les modes de pensée.
Dans le mode de pensée néolibéral, le monétarisme tient une place essentielle. Mais il ne représente, en fin de compte, que l’un des éléments d’une pensée plus globale. Le monétarisme est un rouage – mais il n’est qu’un rouage – d’une machinerie bien plus vaste. De ce fait, si l’on suit les recommandations des économistes hostiles au monétarisme et que l’on retire ce rouage sans remplacer l’engrenage dans son ensemble, on casse la machine sans être capable d’y substituer une machine alternative.
Le monétarisme est, en fin de compte, une doctrine qui vise à faire de l’État l’arbitre neutre de la politique monétaire. Le problème est que sortir du monétarisme sans penser plus largement le rôle de l’État et sans réfléchir aux manières alternatives d’organiser l’économie n’est pas possible. À partir du moment où l’on admet que l’État ne doit pas simplement être un superviseur neutre de la monnaie, mais que le pouvoir politique peut utiliser l’outil monétaire pour agir de manière discrétionnaire sur l’économie, il faut admettre que l’État pourrait avoir le droit d’agir de la même façon sur bien d’autres marchés. Pourquoi les taux d’intérêt devraient-ils être décidés de manière politique mais pas les autres prix ? Et si l’on admet que le rôle de l’État peut être d’établir des prix à la place des marchés, jusqu’où va-t-on dans cette logique ?
Cette question est d’autant plus importante que nos institutions et la manière de penser des experts et des économistes ont intégré le principe qu’une économie de marché n’est pas un simple espace où l’on échange librement, mais que c’est surtout un système au sein duquel les prix sont déterminés par des marchés en concurrence. Cela n’a pourtant pas toujours été le cas. En fait, on pourrait même affirmer qu’avant les années 1970, ce n’était pas du tout le cas. Beaucoup de prix étaient alors largement administrés par les autorités politiques et cela ne posait aucun problème à personne. Ce n’est qu’à partir des années 1970, et plus encore dans les années 1980 et 1990, que la logique s’est inversée.

