Une étude récente témoigne d’un phénomène « free lance » qui s’amplifie et qui change de nature. Travailleurs et travailleuses à se lancer en indépendants sont en effet de plus en plus qualifiés, un effet peut-être des reconfigurations amenées par la crise sanitaire. Nous avions montré dans des recherches précédentes comment celle-ci a questionné le rapport au travail et suggéré reconversions et mobilités.
Un autre mot clé se détache, celui de « multi-activité » ou « slashing ». Valérie Duburcq, directrice du domaine Transformation « Pratiques de Travail Collectives » chez Orange, en témoigne :
« Nous sentons une envie des salariés d’avoir une multiactivité soit au sein de la même entreprise soit au sein de plusieurs. On voit de plus en plus un lien avec l’entreprise, qui est en train de changer. Avant, il était admis que son travail se passait au sein d’une même entreprise. Aujourd’hui, on veut couper son temps entre plusieurs activités et plusieurs entreprises. »
Nous trouvons ici les ingrédients du slashing, défini dès 2007 dans un ouvrage de l’essayiste américaine Marci Alboher. Le slashing, c’est l’articulation volontaire de plusieurs activités professionnelles radicalement différentes. Ce mode de travail atypique sort du cadre du CDI à temps plein et reste méconnu : récent, on le confond encore avec la pluriactivité subie. En France, les slashers sont confrontés à une mauvaise identification professionnelle qui reste peu analysée. Notre recherche vise à comprendre comment les principaux concernés gèrent cette mauvaise identification sociale.
Immatures, opportunistes… Vraiment ?
Nous sommes repartis d’un cadre théorique précédemment établi par la littérature afin de décrire les situations où l’individu estime qu’une des facettes de son identité est mal prise en compte par son environnement. C’est bien ce qui est à l’œuvre chez les slashers, comme l’enseigne l’analyse des 38 entretiens que nous avons menés auprès de cette catégorie de travailleurs. Ils et elles choisissent de combiner des activités variées par passion. L’un d’entre eux explique :
Dans les faits, cette forme d’emploi reste mal identifiée, souvent confondue avec la pluriactivité subie, et perçue négativement tant sur le plan personnel que professionnel :
« On doute de mon professionnalisme. On doute de ma volonté de m’investir dans mon activité. »
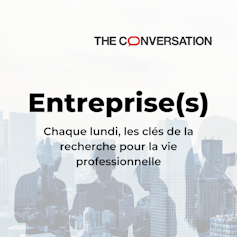
Chaque lundi, que vous soyez dirigeants en quête de stratégies ou salariés qui s’interrogent sur les choix de leur hiérarchie, recevez dans votre boîte mail les clés de la recherche pour la vie professionnelle et les conseils de nos experts dans notre newsletter thématique « Entreprise(s) ».
Les slashers sont souvent réduits à des stéréotypes liés à leur âge ou leur genre. Ils peuvent être perçus comme immatures ou opportunistes :
« Comme je suis jeune, on perçoit le slashing comme une étape où je suis censé me chercher. Beaucoup ne voient pas cela comme un choix de carrière définitif. »
Professionnellement, ils sont souvent jugés incapables de gérer efficacement leurs différentes activités. Cette perception erronée crée un stress supplémentaire :
« Je dois sans cesse prouver que je suis engagé dans le travail. »
Ces asymétries identitaires proviennent aussi bien des clients que des collègues ou supérieurs hiérarchiques.
Vivons cachés ?
Les slashers développent alors des stratégies d’adaptation variées pour équilibrer ces deux dimensions, trois principalement.
La première est la militance : les travailleurs promeuvent leur mode de vie professionnelle, se montrent proactifs et investissent dans des réseaux professionnels et associatifs pour valoriser leur identité duale. Il y a une volonté de faire accepter cette réalité :
« Je suis un militant du slashing. Je cherche à convaincre que les slashers sont des travailleurs de valeur. Je ne rate jamais une occasion de faire une présentation soulignant l’intérêt pour tous du slashing. »
Une autre repose sur l’authenticité : les intéressés équilibrent leur identité professionnelle en recherchant la reconnaissance authentique de leurs différentes activités. Ils s’appuient sur des réseaux de soutien et partagent leur expérience avec des collègues ouverts à la diversité professionnelle :
« Le slashing c’est d’abord se retrouver. Je me suis cherché pendant toute ma première partie de carrière. Maintenant, à 40 ans, je veux du sens. Je suis fier de ce choix qui n’est pas facile, notamment en termes financiers. J’en parle autour de moi au travail. »
D’autres, dernière stratégie, font le choix de la clandestinité : ils préfèrent cacher leur pluriactivité, craignant les jugements négatifs de leurs collègues et supérieurs. Ils gèrent leur identité en secret. C’est le cas de Pascale, guide touristique et comptable :
« Pour moi, le dicton “pour vivre heureux, vivons cachés” s’applique parfaitement. J’ai eu des expériences douloureuses de rejet, de doutes sur mon professionnalisme. J’ai choisi d’être la plus discrète possible. »
Le slashing est donc à considérer dans toute sa complexité, ce qui inclut les stratégies développées par les individus pour gérer leur identité professionnelle duale. Elle appelle également à une meilleure reconnaissance de ces formes d’emploi atypiques et à une adaptation des environnements professionnels pour accueillir cette diversité.

