Lors de l’assemblée générale de Stellantis, le 16 avril dernier, le vote en faveur d’une rémunération du PDG Carlos Tavares pouvant atteindre 36,5 millions d’euros en 2023, a suscité l’indignation de nombreuses parties prenantes, qui l’ont qualifiée d’« indécente ».
L’indécence, un terme omniprésent aujourd’hui dans les débats concernant le comportement des dirigeants économiques, paraît mériter une tentative de définition, qui, en l’état, reste floue et incertaine. Ce mot nous semble pourtant ouvrir des perspectives et des pistes de réflexion importantes, notamment en relation avec la « common decency » orwellienne qui promeut une éthique des vertus (ordinaires), pour tenter de répondre à la crise actuelle du leadership.
Pour cela, un détour par la pensée de George Orwell s’impose. L’auteur de 1984 affirmait en effet ceci :
« Ce qui me fait peur… c’est leur incapacité à réaliser que la société humaine a besoin comme fondement des valeurs de décence commune, quelle que soit la forme politique ou économique qu’elle utilise. »
Bien que Orwell n’ait jamais théorisé explicitement sa notion de « common decency », il l’a si souvent et explicitement utilisée qu’elle est devenue un élément central de son héritage intellectuel.
La décence ordinaire selon Orwell
Orwell soutenait que le respect de tous y compris des plus défavorisés parmi les « gens du commun » est le fondement d’un comportement décent et implique la réduction des inégalités les plus choquantes. Il voulait aussi mettre en évidence l’éloignement des élites vis-à-vis de la réalité des « gens simples » ayant pour corollaire l’oubli de la décence ordinaire. La « décence commune » peut alors être interprétée comme une capacité à différencier le bon et le mauvais, une forme d’exactitude morale, comme le développe Bruce Bégout dans son essai De la décence ordinaire. Elle englobe des qualités telles que la justice, l’humanité, l’humilité et le soutien mutuel. Et tente de donner une réponse hardie à ce qu’il faut bien appeler, parfois, la vulgarité de certaines élites.
Au début de ses travaux, George Orwell estimait d’ailleurs que seule la classe ouvrière était capable de décence commune. Avec le temps, il a élargi la notion aux employés mais non toutefois aux personnes privilégiées dont le style de vie, la déconnexion avec la réalité des conditions de vie des plus modestes et le « pouvoir » qu’elles ont entre leurs mains rendaient impossible la préservation de cette décence acquise par l’expérience. Plusieurs auteurs ont par la suite résumé la décence à l’absence d’humiliation. C’est, par exemple, le cas d’Avishai Margalit (La société décente, 1999) qui définit une société décente comme celle dont les institutions n’humilient pas les personnes. Le philosophe Bruce Bégout, qui a étudié l’auteur anglais, explique lui aussi qu’est décent « ce qui n’humilie pas l’individu ».
Notons enfin que si le respect de l’autre est une notion centrale de la common decency, elle ne se limite pas à la non-humiliation. La décence commune se veut plus large et fait également référence à d’autres vertus telles que la justice, l’égalité, l’humanité et la solidarité. La décence commune valorise les vertus permettant de respecter autrui suffisamment pour qu’il ne se sente pas humilié, mais justement considéré.
L’indécence contemporaine
De fait, en examinant la manière avec laquelle l’indécence est perçue, on constate très vite que les rémunérations des dirigeants jugées excessives sont souvent à l’origine de l’indignation. Salaires exorbitants, parachutes dorés, avantages sociaux, retraites chapeaux ; ces faits révoltent autant les salariés, les syndicats, les journalistes que la société tout entière. Ce qui indigne ici, ce n’est pas le montant absolu, mais l’écart vertigineux avec les salaires des employés (souvent 400 fois inférieurs). La question de la méritocratie tant vantée se pose alors.
Il faut d’emblée noter que d’autres formes d’indécence prennent forme : on pourrait penser à la FIFA et son président Gianni Infantino, qui a embelli la réalité à propos des conditions de travail des ouvriers du bâtiment à Qatar lors des préparatifs pour la Coupe du Monde 2022, a refusé de payer les compensations aux blessés et aux familles des travailleurs décédés, tout en « empochant des milliards de dollars » selon Human Rights Watch. Les explications de Gianni Infantino ont rencontré un écho unanime dans la presse française lui reprochant à la fois indécence et cynisme.
Des accusations d’indécence, plus récentes encore, révèlent des aspects clés de l’évolution de cette notion : les puissants sont de plus en plus dénoncés pour hypothéquer l’avenir des générations futures. L’irresponsabilité de certains dirigeants d’entreprises à l’égard de l’environnement, le lobbying contre les règlementations écologiques au profit des énergies fossiles, ainsi que leur mode de vie à fortes émissions de carbone, sont autant de preuves d’indécence que dénoncent les observateurs de tous ordres. Tout se passant comme si une nouvelle réalité émotionnelle semblait avoir exacerbé le sentiment d’injustice sociale et environnementale, transformant l’inégalité en une expérience personnelle et intime. Et c’est dans ce contexte que la notion d’indécence a acquis progressivement une importance nouvelle, se référant alors au sentiment partagé d’abaissement et de déni de dignité. Car, le plus souvent, mépris, humiliation et indignation s’entremêlent dans la condamnation de l’indécence.
L’hubris ou le leadership indécent
En élargissant l’analyse, nous pouvons établir un lien entre l’indécence et un autre comportement largement discuté dans les médias, surtout après la crise financière de 2008, l’hubris. Cette pathologie de l’ego a été abondamment étudiée dans la recherche en management et en économie, depuis la publication en 1986 du papier de recherche fondateur de Richard Roll « The hubris hypothesis of corporate takeovers », même si la notion remonte à la Grèce antique. Icare en est l’un de ses plus anciens représentants, volant trop près du soleil, et oubliant sa condition et ses limites humaines. L’hubris est définie par une perception exagérée de soi-même, la conviction d’être au-dessus des autres humains, un certain éloignement de la réalité aussi, combiné avec une imperméabilité à la critique.
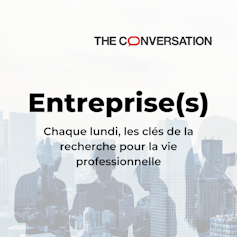
Chaque lundi, que vous soyez dirigeants en quête de stratégies ou salariés qui s'interrogent sur les choix de leur hiérarchie, recevez dans votre boîte mail les clés de la recherche pour la vie professionnelle et les conseils de nos experts dans notre newsletter thématique « Entreprise(s) ».
Or le CEO indécent est précisément celui ou celle qui a une opinion exagérée de ses mérites et de ses droits, il/elle est déconnecté(e) de la réalité des gens, et peut sembler faire preuve alors d’une absence de compassion et d’intérêt pour autrui. L’indécence devenant alors une sorte de manifestation, de symptôme de l’hubris.
Read more: « Chief truth officer » : parler-vrai et leadership
Car on peut considérer que la décence constitue une condition de possibilité d’un leadership éthique. La notion de décence implique certes une ambition modeste (et pourtant même modeste, elle fait souvent défaut aujourd’hui). La décence ne représente pas un niveau d’excellence intégral ni une quête de perfection absolue, en matière de leadership, mais simplement l’adoption d’un comportement acceptable et adéquat. Ici ce n’est pas la « grandiosité du leadership » qui prévaut mais plutôt la reconnaissance du caractère vulnérable de notre condition, humaine et environnementale. À l’attention du Duc de Chevreuse, dans un court traité d’éducation destiné aux jeunes gens bientôt détendeurs du pouvoir, le philosophe Blaise Pascal ne prévenait-il pas déjà que « tous les emportements, toute la violence et toute la vanité des grands viennent de ce qu’ils ne connaissent point ce qu’ils sont » ? Cette phrase constituant même la conclusion de son 1er discours sur la Condition des Grands_.
La prise en compte de la vulnérabilité
De telle sorte qu’il semble indispensable aujourd’hui que les dirigeants économiques, tout comme les politiques, prennent davantage conscience d’une certaine vulnérabilité de la condition humaine, et par là même de leur propre situation. La vertu d’humilité (en réponse aux humiliations), non l’humilité polie ou stratégique, celle de la fausse modestie, pourrait les y aider, afin de développer le désir, au cœur de tout management digne de ce nom, de servir quelque chose, une cause – ou un projet – plus grands qu’eux-mêmes.
Or « la véritable humilité, écrivait Bernanos dans le Dialogue des Carmélites, c’est d’abord la décence ». Ce, d’autant plus que le XXIe siècle nous confronte à des défis qui exigent des dirigeants dotés de quelques vertus morales : créer ou maintenir le développement économique dans un monde aux ressources limitées constitue un défi bien différent de celui auquel nous avons été habitués dans un monde où les ressources étaient considérées comme infinies. L’effondrement environnemental et les crises sociétales qui en résulteront feront appel à des vertus telles que la prudence, la tempérance, et le courage du parler-vrai. Toutes ces vertus seront nécessaires pour faire face aux situations de leadership extrêmes qui nous attendent. Concluons donc sur la prudence et la tempérance, vertus aussi rares qu’ordinaires. Des vertus qui se réfèrent, en dernier ressort, à la juste mesure, à un équilibre optimal, à ce que les Grecs anciens appelaient le « metron ». Le souci de la bonne proportion, la culture rapport harmonieux entre quantité et qualité, en bref, tout le contraire de l’hubris.

